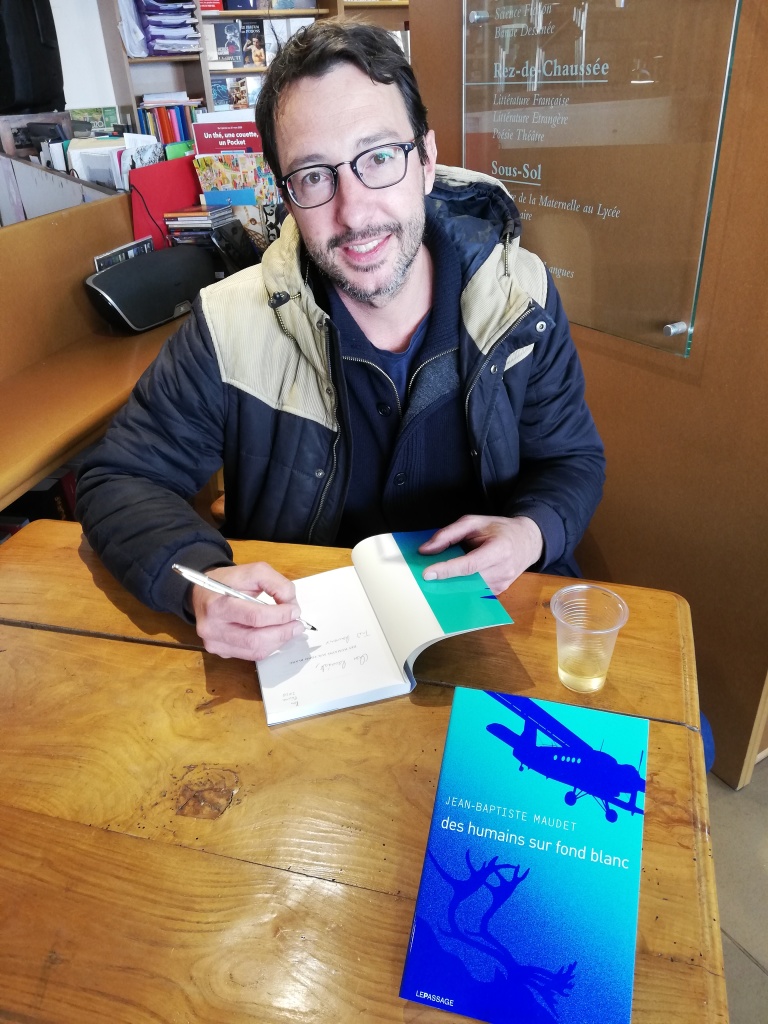Portrait de Dominique Memmi par Paule Santoni
Dans votre roman Manchester dream, le cœur de l’architecte, vous faites vivre et parler l’architecte Franck Gehry, qui a construit la magnifique musée Guggenheim de Bilbao, mais aussi celui de la fondation Vuitton à Paris par exemple.
–Quel a été le point de départ qui vous a donné envie d’écrire ce roman ?
Je travaillais et lisais des articles sur le traitement des consommateurs dans le domaine de la grande distribution. Comment fait-on de nous des consommateurs insatiables ? Comment organise-t-on nos déplacements dans un supermarché ?
Puis, de lectures en lectures je me suis davantage intéressée à la consommation culturelle, celle d’aujourd’hui et celle d’hier. Et comme le découvre Gehry dans mon roman, j’ai découvert dans un ouvrage de muséologie deux lignes qui évoquaient ce grand événement qui a eu lieu à Manchester en 1857.
Je ne pouvais pas passer à côté, tout simplement parce que c’est exactement ce qui me travaille en tant qu’autrice, à savoir, la question de l’art dans nos sociétés ; sa place, son traitement social, ses enjeux commerciaux etc.
–Pourquoi avoir eu envie d’en faire un roman d’ailleurs, est-ce pour la liberté et le plaisir de pouvoir y ajouter tout ce que l’imaginaire de l’auteur peut nous apporter ?
J’ai choisi la forme romanesque parce qu’il me fallait réunir deux époques, deux moments cruciaux de l’histoire de l’art qui se faisaient écho par-delà le temps. Seule la fiction pouvait me permettre de jouer avec ces doubles espaces.
–Il me semble difficile de faire vivre des personnages réels si proches de nous. Et pourtant, tout au long de ma lecture, j’ai eu l’impression que c’était bien lui qui me parlait. Comment aborde-t-on Franck Gehry pour lui donner cette réalité et nous faire croire que nous avons passé 150 pages à ses côtés ?
Frank Gehry m’a facilité le travail parce que sa vie est un véritable roman, il est aisé de travailler autour de personnages authentiques et singuliers.
–Je connaissais le Crystal Palace de Londres pour en avoir vu des représentations au V and A museum à Londres. Mais ici, vous me faites découvrir cette incroyable « Art Treasures Exhibition, Manchester 1857 » qui a été semble-t-il un événement exceptionnel.
Qu’est-ce qui fait qu’à un moment vous avez eu envie de le relier à la création du Guggenheim de Bilbao ? Avez-vous retrouvé des informations à ce sujet indiquant le cheminement de l’architecte ou est-ce né de votre volonté d’auteur ?
Ce moment inédit et pourtant oublié de l’histoire de l’art répondait aux mêmes enjeux que la construction du Guggenheim à Bilbao. Faire sortir l’art des espaces privés et le rendre public. Se faire rencontrer les œuvres et le peuple. De grands noms de la littérature se sont intéressés à l’exposition de 1857 : Flaubert devait se rendre à Manchester, Dickens y était présent, tout comme Elisabeth Gaskell, John Ruskin, Engels et tant d’autres. Vous imaginez l’enjeu social et artistique de l’événement !
C’est le moment où la perception du monde est bouleversée par les inventions liées à l’image, à la couleur, aux réseaux télégraphiques, tout comme le monde de Gehry va être bouleversé par les innovations numériques.
J’ai choisi Frank Gehry parce que sa démarche est celle d’un artiste. Ses réalisations sont fortement inspirées par les sculpteurs et les peintres. Mais ici c’est avant tout un personnage de fiction. Le Frank Gehry de « Manchester Dream » est imaginé, il se déploie à partir d’éléments du réel certes, mais c’est la romancière que je suis qui façonne sa volonté et ses paroles.
–J’imagine que vous avez visité le musée Guggenhiem de Bilbao, un musée que j’aime énormément, en particulier pour son architecture. Mais vous, qu’en avez-vous pensé ?
Ce Léviathan de titane qui nage entre ciel et rivière m’a littéralement bouleversée. J’ai cependant été moins convaincue par les œuvres qui y étaient exposées. Sans doute le choc esthétique de l’édifice de Gehry rend la visite intérieure plus difficile. On attend encore ce bouleversement, on est dans le désir inassouvi de ce premier choc.
–Comment vous est venue l’idée d’étudier un tel projet, celui de sa création, le choix de l’architecte, du lieu ?
J’avais écrit deux versions où Frank Gehry n’apparaissait pas. Et une nuit, il m’est apparu, c’était comme une révélation.
–Cela représente un travail de longue haleine, mais si l’on devait le quantifier, ce serait combien de temps pour les recherches et pour l’écriture de ce roman ?
C’est difficile de quantifier ce travail mais ce que je peux vous dire c’est qu’il y a plus de 6 années de lectures, de recherches dans les archives, de voyages à Manchester, à Bilbao, plusieurs versions du texte et bien sûr des réécritures. Mais ce long travail m’a appris beaucoup et m’a rendue heureuse.
–Pensez-vous que l’on peut dire que le projet de modifier et revitaliser la ville industrielle pour en faire une ville d’art est réussi ?
C’est une ville très visitée depuis la création du Guggenheim. Une ville qu’on regarde, où il y a de l’art, c’est certain.
Mais est-ce que Bilbao est devenue une véritable ville d’art ? Je ne sais pas. Je ne suis pas historienne mais romancière.
Tout roman procède d’une inquiétude, ici ma question est celle de la place de l’art dans la société. Et bien sûr le questionnement se poursuit au-delà du roman.
– L’art prend dans ce roman toute sa place, et après tout, l’écrivain est aussi un artiste à part entière, au même titre que le peintre ou le musicien. Est-ce quelque chose d’important pour vous dans la vie de tous les jours, et si oui comment cela se manifeste-t-il ?
Je suis née dans une famille où la fabrication des choses était très importante. Mon père était berger. J’ai gardé de cette époque l’amour des choses faites main, comme un livre, une peinture, une sculpture, un édifice. Mais tous les jours, il y a cette inquiétude que je partage avec Julien Gracq, celle que l’objet d’art soit noyé dans le monde industriel. Je crois qu’une des fonctions de l’art est de remettre en question la consommation.
–J’ai beaucoup aimé Marie Alice, ce personnage indispensable que l’on découvre un peu tard mais qui a tellement d’importance à mes yeux. D’où vient cette femme incroyable que l’on aimerait tous rencontrer ?
L’art doit être dans la vie, voilà ce que nous dit Marie Alice, voilà ce qu’elle nous propose. Il faut apprendre à entrer dans un musée mais aussi à en sortir par l’expérience. Le danger est d’institutionnaliser l’art.
Marie Alice est acrobate, son métier est de maîtriser le déséquilibre, elle est en quelque sorte la métaphore du déséquilibre entre le peuple et l’art, voilà pourquoi elle est effectivement un personnage indispensable. C’est une figure de progrès.
–Je me souviens d’un précédent roman, le voyage de la fanfare, qui est basé sur un événement historique récent. Est-ce nécessaire pour vous de vous appuyer sur le réel pour écrire ?
Pour moi il n’y a pas de séparation entre réel et fiction, ils s’entretiennent, conversent comme deux personnes qui auraient chacune sa propre histoire.
–Êtes-vous également une lectrice en plus d’être autrice de romans ? Et si oui, quel titre auriez-vous envie de nous conseiller ?
Enfant, la lecture a été pour moi une révélation comme dans mon roman l’est le tableau de Turner pour Edna.
Écrire c’est lire et avant même d’écrire il y a la lecture.
J’aurais de multiples livres à conseiller mais ceux qui me viennent là immédiatement à l’esprit: « L’allègement des vernis » de Paul Saint Bris, « La plus secrète mémoire des hommes » de Mohamed Mbougar Sarr. Un classique qui ne l’est pas : « Un roi sans divertissement » de Giono.
Je ne connaissais pas les éditions Marie Romaine, que pourriez vous nous en dire en quelques mots ?
C’est une jeune maison d’édition indépendante qui a tout pour devenir grande tant son éditrice est impliquée auprès des auteurs et de leurs textes. La ligne éditoriale est généraliste avec trois collections : littérature/ essais/ spiritualité.
Merci d’avoir fait vivre pour nous Franck Gehry, Deane, et tous les autres, j’ai eu l’impression que je les avais réellement rencontrés grâce à vous. Un grand merci pour vos réponses, je souhaite longue et belle vie à ce roman.
Merci de tout cœur.