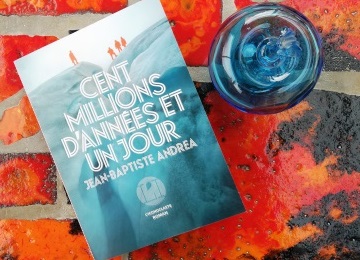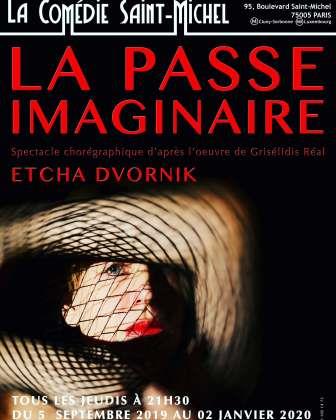De Reynolds et Gainsborough à Turner, l’âge d’or de la peinture anglaise à travers les chefs-d’œuvre de la Tate Britain, de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle

On y trouve portraits, peintures d’histoire ou animalières, paysages et aquarelles. Des œuvres assez étonnantes par leur construction, leurs couleurs, et leur taille. Dans les premières salles, les portraits sont si gigantesques qu’ils semblent à l’étroit dans l’espace du musée. Par la suite, quelques paysages ont au contraire des tailles bien modestes, quand on connait par exemple l’œuvre de Turner.
Vers 1760, puis tout au long du règne de George III, soit jusqu’en 1820 environ, la société anglaise se transforme et avec elle l’art et la culture connaissent une mutation importante. Sans pour autant renier les grands maîtres précédents, les peintres anglais s’essaient à de nouveaux styles, de nouvelles techniques, renouvelant le genre du portrait, les rendant plus sensibles et même expressifs, ou celui du paysage et de la peinture d’histoire.
Jusqu’au moment de la révolution française, on assiste au développement du paysage comme un genre en soi. Le goût en est sans doute favorisé par les échanges que font les artistes avec l’étranger, notamment lors de leur Grand Tour au cours desquels les peintres se familiarisent avec les œuvres italiennes en particulier. Après la révolution, les voyages étant plus compliqués, ils se tournent vers leurs propres paysages et mettent en valeur la campagne anglaise.
Et l’on peut voir au hasard des salles :

Ce portrait portrait où le personnage ne regarde pas devant lui, une construction assez surprenante et très belle.
Mrs Robert Trotter par George Romney. On sait que le peintre pouvait réaliser un portrait avec seulement quelques séances de pose. Ce portrait est novateur car seul le personnage est travaillé alors que le fond est à peine esquissé, presque flou. Contrairement à un portrait plus classique, avec un arrière-plan très fouillé.
À la façon de…

Francis Cotes, Paul Sandby 
Un Hunter gris avec un palefrenier et un lévrier à Creswell Crags
Francis Cotes, Paul Sandby, l’artiste fait le portrait d’un peintre spécialiste du pastel en le représentant à sa fenêtre, ses crayons de pastel à la main.
J’ai apprécié dans ce tableau de George Stubbs Un Hunter gris avec un palefrenier et un lévrier à Creswell Crags le regard que l’on devine entre le chien et le cheval.
L’empire colonial…
Mais il ne faut pas oublier la grande période de l’empire colonial Anglais, en particulier en Inde, que l’on retrouve notamment dans des paysages ou des portraits de famille. Ici un détail, une jeune fille et sa jeune servante indienne.
Ou encore, le peintre, découragé car ne recevant plus aucune commande, sombre dans l’alcool, puis se suicide. Ici il pose devant sa toile blanche…
Ce n’est pas forcément une exposition inoubliable, mais de belles choses à voir.
Que voir : L’âge d’or de la peinture anglaise, de Reynolds à Turner
Où : Musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard 75006 Paris
Quand : jusqu’au 16 février 2020, tous les jours de 10h30 à 19h, nocturne jusqu’à 22h le lundi